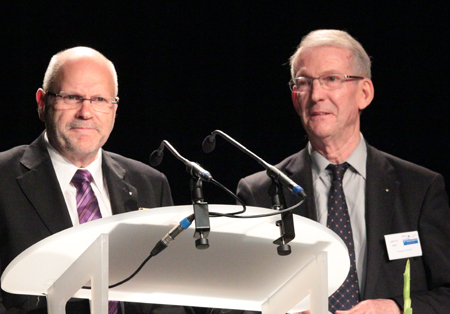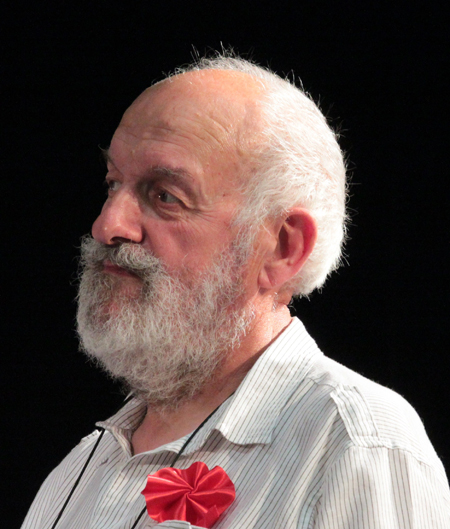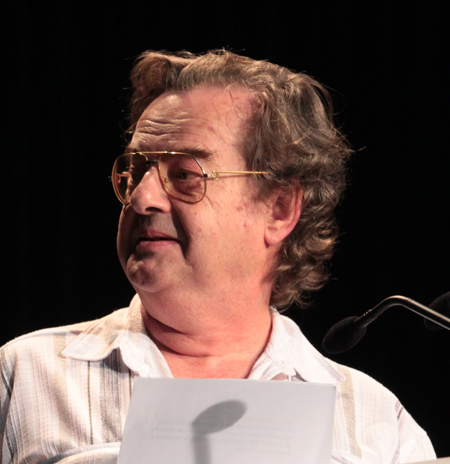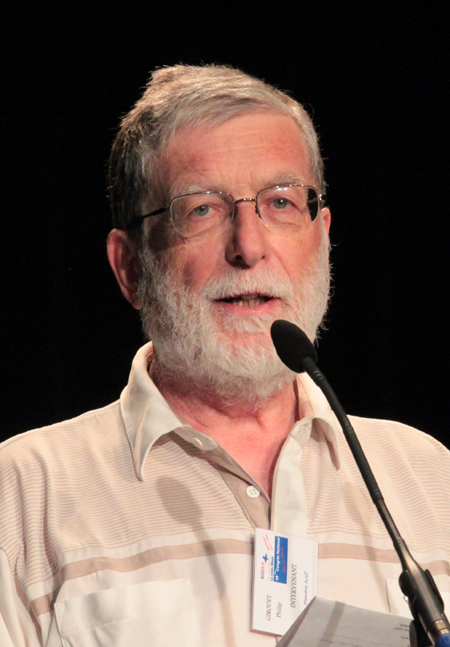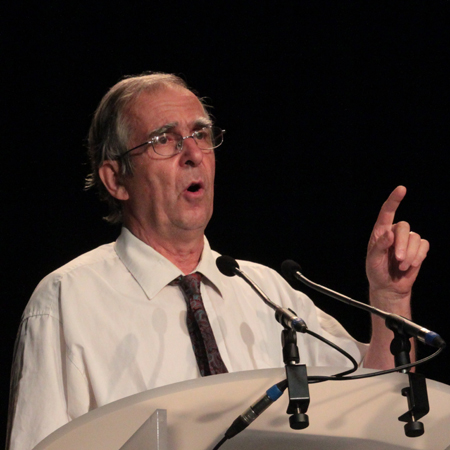Danser non-stop, à fond, jusqu’au bout de la nuit. Jean-Christophe a consommé pendant des années du Red Bull associé à de la vodka, à raison de cinq ou six par soirée. Ce jeune consultant en informatique, qui souhaite rester anonyme, a répondu à l’appel à témoignages lancé sur le site du Monde.fr. Il se décrit comme un gros consommateur de Red Bull depuis ses 18 ans. Aujourd’hui, il en a 28, et boit au moins une canette tous les soirs, "pour pouvoir faire seize heures de programmation informatique par jour devant l’écran". Associé à de la marijuana,"cela crée une sorte de "transe"". Du coup, il tient jusqu’à 5 ou 6 heures du matin.
Danser non-stop, à fond, jusqu’au bout de la nuit. Jean-Christophe a consommé pendant des années du Red Bull associé à de la vodka, à raison de cinq ou six par soirée. Ce jeune consultant en informatique, qui souhaite rester anonyme, a répondu à l’appel à témoignages lancé sur le site du Monde.fr. Il se décrit comme un gros consommateur de Red Bull depuis ses 18 ans. Aujourd’hui, il en a 28, et boit au moins une canette tous les soirs, "pour pouvoir faire seize heures de programmation informatique par jour devant l’écran". Associé à de la marijuana,"cela crée une sorte de "transe"". Du coup, il tient jusqu’à 5 ou 6 heures du matin.
Eric, ancien commercial, faisait 2 000 à 3 000 kilomètres de route par semaine. Lassé des cafés, il a fini par goûter une canette de boisson énergisante. Puis à enconsommer une à quatre par jour du mercredi au vendredi. "Cela m’aidait à tenir le rythme et à repousser mes limites." Mais un jour, il s’est senti mal : plus de force dans les jambes, battements de coeur irréguliers. C’était il y a trois ans, il avait 27 ans. Son médecin impute ces troubles à la fatigue et au stress. Quelques mois plus tard, le même malaise survient. "Cette fois, j’ai réfléchi à mon hygiène de vie et j’ai émis l’hypothèse que ma consommation régulière de ces boissons pouvaitjouer un rôle. Je les ai alors bannies, et n’ai plus eu d’arythmie cardiaque", raconte Eric.
Le 6 juin, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a fait état de six remontées d’effets indésirables graves (épilepsie, coma, tremblement, angoisse) depuis 2009, dont deux décès par arrêt cardiaque, pour lesquels le lien avec la consommation de boisson énergisante est en cours d’évaluation. L’alerte semble fonctionner puisque "nous avons reçu six autres signalements, qui sont en cours d’examen", explique le professeur Irène Margaritis, chef de l’unité évaluation des risques liés à la nutrition à l’Anses.
Le vodka-Red Bull est "le" cocktail à la mode dans les boîtes de nuit et sa consommation ne cesse de croître chez les jeunes. Red Bull mais aussi Monster,Dark Dog, Burn, Frelon Detox… toutes sont à portée de main, dans les linéaires des supermarchés, les clubs de sport… et ne séduisent pas seulement les fêtards, mais aussi les adeptes du fitness, les travailleurs de nuit, les addicts auxjeuxvidéo… "Ma Monster est ma seconde vie", dit Emmanuel, un étudiant travailleur de 21 ans.
Mais comme Eric, ils sont nombreux à faire part d’effets indésirables. Des pincements au coeur pour cet étudiant à Londres, de légers vertiges, des sueurs, le coeur qui "bat tellement fort que j’ai du mal à récupérer", pour Karim, étudiant marseillais. D’autres font état de déprimes passagères et inhabituelles, de "descentes" après la consommation.
Le lendemain d’une soirée où elle avait bu quatre ou cinq canettes de Red Bull, sans alcool, Sophie était en pleine forme malgré seulement trois heures de sommeil. La trouvant agitée, ses parents - elle a un père médecin - se sont inquiétés. Mais pour elle, "cette boisson permet de tenir. Le week-end, on a envie de se lâcher. Avec une ou deux canettes avant de partir sur la piste je sens nettement la différence".
La France a été l’un des derniers pays à avoir accepté la commercialisation de ces boissons énergisantes. En 2001, l’Anses - Afssa à l’époque - avait rendu plusieurs avis dans lesquels elle faisait état de doutes vis-à-vis de l’innocuité de ces boissons. Le Red Bull et les boissons analogues ont finalement été mises sur le marché en mai 2008, grâce au feu vert du ministère de l’économie, et malgré l’opposition du ministère de la santé "au nom du principe de précaution".
"Combien faudra-t-il d’accidents pour prendre des décisions ? se demande le docteur Laurent Chevallier, nutritionniste, membre du Réseau environnement santé. Ce ne sont pas des produits indispensables. On peut s’étonner que l’Europe n’ait pas pris de mesures.""Notre objectif est d’établir scientifiquement une relation de cause à effet, indique le professeur Margaritis. Une étude devrait être finalisée à l’automne 2012 pour identifier les profils, les modes de consommation, les quantités."
C’est surtout l’association avec l’alcool qui inquiète. Ce cocktail détonnant correspond au binge drinking ("ivresse express"), très en vogue chez les jeunes."Les adolescents utilisent ces boissons énergisantes pour boire encore plus et plus longtemps", explique le psychiatre Xavier Pommereau, chef du pôle de l’adolescent au CHU de Bordeaux. Parce que ces boissons diminuent la perception des effets de l’alcool, les médecins déconseillent très fortement le mélange. "Les scientifiques se posent actuellement la question de la toxicité de la taurine lorsqu’elle est associée à de l’alcool", ajoute le docteur Pommereau. Outre la taurine, ces boissons contiennent des ingrédients "stimulants" : caféine, guarana, ginseng, vitamines, D-glucuronolactone (substance qui peut être toxique), etc.
Mais pour la plupart des jeunes, "c’est moins toxique que des amphétamines ou de l’ecstasy", sourit un fonctionnaire nantais, pour qui "cette polémique autour de quelques cas litigieux est un sacré non-événement". Certains, jeunes ou moins jeunes, en consomment "pour se tenir éveillés" et "ne voient pas le problème". Pour d’autres, tout cela est un faux débat. "Le vrai danger pour la jeunesse, c’est la consommation très tôt de grandes quantités d’alcool fort", résume Paul, un trentenaire parisien.
"Depuis le début des années 2000, on observe deux phénomènes nouveaux : l’âge de plus en plus jeune de la prise d’alcool, et l’alcoolisation massive, notamment des filles. J’ai vu des gamines de 14 ans avec des bouteilles de vodka dans leur sac", raconte le docteur Pommereau. Sur les quinze patients aujourd’hui dans son service, deux ont 12 ans.